Les paysages-écrans du Rwanda. Première partie
Plus de vingt ans après le génocide des Tutsi, hormis les quelques sites mémoriaux, les traces du génocide sont peu visibles dans les paysages rwandais. Les collines à perte de vue sont toujours aussi belles et majestueuses, mais il m’a fallu plusieurs voyages au Rwanda pour m’abandonner à la splendeur des vastes étendues vertes, sans être envahie par une étrange impression de vide et d’angoisse diffuse. J’ai dû apprendre à les regarder autrement, à me familiariser avec elles, faire la part des choses, mettre de côté d’autres images atroces, d’autres voix entendues sur ces mêmes lieux. J’ai tenté de traduire cette impression paradoxale de vie et de mort, de fascination et de répulsion par le concept de « paysage-écran », tout en interrogeant la mémoire des lieux et des territoires de l’après génocide : comment un paysage qui a connu des massacres de grande ampleur peut-il offrir une visibilité de l’Histoire ?
Par définition, ce qui différencie la nature du paysage, c’est que ce dernier n’existe que dans la mesure où il est observé par quelqu’un : « Le paysage est manière de lire et d’analyser l’espace, de se le représenter, au besoin en dehors de la saisie sensorielle, de le schématiser afin de l’offrir à l’appréciation esthétique, de le charger de significations et d’émotions. En bref, le paysage est une lecture, indissociable de la personne qui contemple l’espace considéré[1] », écrit Alain Corbin. C’est une portion de la nature qui est transformée en représentation, en image à regarder ou à méditer. Le mot « écran » possède un double sens, signifiant un espace de projection comme l’écran d’un cinéma, mais également ce qui fait obstacle, ce qui obstrue la vue ou la pensée. Ainsi j’entends par « paysages-écrans » des paysages qui révèlent une tension dialectique entre le proche et le lointain, qui reflètent une paradoxalité engendrée par la hantise du passé dans le présent. Le doute et le malaise qui peuvent surgir à tout moment finissent par saper la confiance que nous avons dans les images de paysage.
 Des écrits de survivants témoignent de cette ambivalence entre l’oubli impossible et le silence de la nature, comme celui d’Elise Rida Musomandera. J’ai rencontré cette jeune femme en avril 2006 lors de mon premier voyage[2] au Rwanda. En 2014, l’année qui marque la 20e année de la commémoration du génocide des Tutsi, elle a publié un récit poignant de son expérience de l’extrême, de la mort des siens dans des conditions atroces, mais aussi du courage et de la ténacité qu’il lui a fallu pour grandir comme « orpheline du génocide » et se reconstruire sans famille et sans repère. Dans les premières pages de son Livre d’Elise, elle écrit :
Des écrits de survivants témoignent de cette ambivalence entre l’oubli impossible et le silence de la nature, comme celui d’Elise Rida Musomandera. J’ai rencontré cette jeune femme en avril 2006 lors de mon premier voyage[2] au Rwanda. En 2014, l’année qui marque la 20e année de la commémoration du génocide des Tutsi, elle a publié un récit poignant de son expérience de l’extrême, de la mort des siens dans des conditions atroces, mais aussi du courage et de la ténacité qu’il lui a fallu pour grandir comme « orpheline du génocide » et se reconstruire sans famille et sans repère. Dans les premières pages de son Livre d’Elise, elle écrit :
« J’ai vécu très peu de temps heureuse, seulement dix ans avec ma famille, mes voisins, mes meilleurs amies d’enfance. C’était alors pour moi un pur moment de vie dans ce bon pays des mille collines, ces collines qui m’ont ensuite tourné le dos quand j’en avais le plus besoin, ces collines qui n’ont jamais accepté de cacher ma famille, ces collines qui m’ont trahie.
Ce bon pays des milles collines est devenu l’un des plus grands tombeaux du monde avec plus d’un million de crânes dans les mémoriaux et partout dans le pays, et parmi ce million de victimes, Tutsi et Hutu modérés, plus de cinquante d’entre elles étaient des membres de ma famille [3]. »
Ce cimetière à ciel ouvert qu’évoque Elise n’a quasiment pas laissé d’empreintes, alors qu’à l’époque, d’avril à août 1994 et bien après, les flancs des collines, les fleuves et les lacs sont jonchés de cadavres abandonnés. Aujourd’hui, la nature a bien repris ses droits sur les traces et les preuves de l’extermination, les paysages montrent « ce qui n’est plus ». Il est très difficile de lire l’histoire du génocide à travers la topographie du lieu, à moins d’être en quête des indices fragiles et ténus qui viennent résister à l’effacement des traces[4]. La destruction se lit par le vide, par la banalité d’un champ en friche abandonné et envahi par des herbes hautes dans certaines parcelles à la lisière du village, mais aussi à travers une étrange impression de calme qui cache mal le silence envahissant des morts.
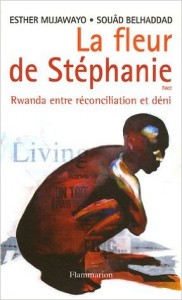 Dans son livre La Fleur de Stéphanie, Esther Mujawayo[5] nous parle avec des mots bouleversants de simplicité et de précision du rapport ambigu qu’elle entretient avec le paysage, en décrivant le site naturel où a eu lieu sa rencontre avec le tueur qui a assassiné, une dizaine d’années plus tôt, sa sœur, ses neveux et nièces :
Dans son livre La Fleur de Stéphanie, Esther Mujawayo[5] nous parle avec des mots bouleversants de simplicité et de précision du rapport ambigu qu’elle entretient avec le paysage, en décrivant le site naturel où a eu lieu sa rencontre avec le tueur qui a assassiné, une dizaine d’années plus tôt, sa sœur, ses neveux et nièces :
« De chez lui, tu vois les bananeraies et les eucalyptus se toiser à distance, et les collines, dont le vert se confond avec le bleu du ciel, s’étendre à perte de vue. La nature est décidemment très jolie au Rwanda, mais la nature, chez nous va aussi de pair avec la mort : tant de défunts sont ensevelis sous les buissons et les roseaux, tant de noyés dans les marais et les lacs. La nature a été salutaire pour ceux qu’elle a cachés mais si souvent complice involontaire des tueurs. Tu as alors l’impression que cette beauté te nargue, que d’ailleurs, tout dans le pays et tout le monde, hormis les rescapés, te narguent, mais en fait, ils ne te narguent pas, ils continuent tout simplement à vivre. Comme le tueur[6]. »
La souveraine beauté du paysage fait corps avec le génocide pour les rescapés. Certes, les restes des défunts sans sépulture ont fini par s’effacer du Rwanda – pays de lait et de miel –, mais les morts demeurent intactes dans leurs souvenirs, comme si les années n’avaient pas de prise, comme si la reconstruction du pays avec ses efforts actuels de modernisation ne pouvait adoucir la peine immense de la perte. La vie d’aujourd’hui est comme irradiée et hantée par l’extermination, mêlant l’avant et l’après génocide dans un lieu et un temps indifférenciés du trauma, ce dont témoigne Elise dans un très beau texte écrit récemment durant les « ateliers de la mémoire au Rwanda »[7] :
« Moi, je suis devenue grande, je suis devenue grande pour marcher à pied chaque matin pendant plus de trois heures pour aller à l’école. Je suis devenue grande pour pouvoir supporter de passer trois jours sans rien manger. Je suis devenue adulte pour supporter le souvenir de la mort atroce. Je suis devenue adulte pour supporter de serrer les mains des tueurs. Je suis devenue adulte pour tout supporter.
Je ne peux pas écouter les cris des danseurs Intore, j’entends les cris des tueurs.
Je ne peux pas regarder les champs de bananiers, je vois les tueurs qui portaient des feuilles de bananiers.
Je ne peux pas voir les supporteurs de Football chanter, je vois les groupes de milice interahamwe qui chantent.
Je ne peux pas entrer dans les églises, je sens la trahison des religieux. Je vois le sang des fidèles sur les murs.
Je ne peux pas revoir de machette, je vois l’arme principale pour tuer les gens.
Je ne peux pas regarder la beauté de ce pays d’après. »
(à suivre)
[1] Alain Corbin, L’Homme dans le paysage, Paris, Textuel, 2002, p. 11.
[2] C’est grâce à Laure Coret que j’ai pu participer au voyage d’études « Croiser les mémoires ensemble », organisé par le Cercle des étudiants rwandais de Belgique, avec le soutien de nombreux partenaires dont la Fondation de la Shoah et l’Université Paris 8.
[3] Elise Rida Musomandera, Le Livre d’Elise, Paris, Les Belles lettres, 2014, p. 15 -16.
[4] Voir Hélène Dumas, Le génocide au village. Le massacre des Tutsi au Rwanda, Paris, Seuil, 2014, en particulier le premier chapitre « Repérer ».
[5] Esther Mujawayo nous a fait l’honneur d’être membre d’honneur du CIREMM.
[6] Esther Mujawayo avec Souâd Belhaddad, La Fleur de Stéphanie. Rwanda entre réconciliation et déni, Paris, Flammarion, 2006, p. 85-86.
[7] Voir le blog https://rwandaateliermemoire.wordpress.com
